Le coeur économique : la mine du Rancié au sein de la vallée de Sem
Entre
la Pique
d’Endron et le pic du Garbié de Brésoul, on suit une direction
nord-est en
dominant de part et d’autre des versants couverts de rhododendrons et
de
myrtilles, végétation typique de la reconquête des estives par le
milieu
naturel.
 Lorsqu’on
arrive au
niveau du pic du Garbié de Brésoul, la crête se sépare en deux
parties :
la branche occidentale court jusqu’au pic de Risoul où elle se perd
dans le
système complexe de falaises calcaires qui plongent dans la vallée du
Vicdessos. La branche orientale s’incurve vers le nord-est en direction
de
Laramade, point de confluence du Siguer et du Vicdessos. Les deux
parties
enserrent l’étroite vallée de Sem sur le flanc de laquelle s’ouvrent
les
galeries de la mine de fer du Rancié. Cette mine
aujourd’hui désaffectée était connue dès
l’Antiquité :
3 bas fourneaux et
10 emplacements de
charbon-nage datant du 3ième siècle ont été mis
à jour entre Sem et
Lercoul. La richesse et la qualité de son minerai, de la pure hématite
rouge ou
brune, associée à de l’oxyde de manganèse, permettait l’obtention d’un
acier
résistant à l’oxydation.
Lorsqu’on
arrive au
niveau du pic du Garbié de Brésoul, la crête se sépare en deux
parties :
la branche occidentale court jusqu’au pic de Risoul où elle se perd
dans le
système complexe de falaises calcaires qui plongent dans la vallée du
Vicdessos. La branche orientale s’incurve vers le nord-est en direction
de
Laramade, point de confluence du Siguer et du Vicdessos. Les deux
parties
enserrent l’étroite vallée de Sem sur le flanc de laquelle s’ouvrent
les
galeries de la mine de fer du Rancié. Cette mine
aujourd’hui désaffectée était connue dès
l’Antiquité :
3 bas fourneaux et
10 emplacements de
charbon-nage datant du 3ième siècle ont été mis
à jour entre Sem et
Lercoul. La richesse et la qualité de son minerai, de la pure hématite
rouge ou
brune, associée à de l’oxyde de manganèse, permettait l’obtention d’un
acier
résistant à l’oxydation.
Par la charte
de 1293, les comtes
ont reconnu « omnibus
et singulis habitatoribus »
aux
habitants le droit
-de
travailler dans les mines de la vallée
-de fabriquer et
d'aiguiser tout instrument de fer
-de faire du
charbon de bois
-d'exporter le fer
hors de la vallée
C’était
conforme au le régime d'utilisation communautaire des richesses
minérales,
coutumier dans l'ensemble des Pyrénées et également avec les droits
d’usage en
vigueur sur le plan agricole. Chaque
mineur disposait du produit de son travail (on a pu parler de
« la mine
aux mineurs »), mais la "police de la mine"
était sous
contrôle des consuls.
Entre
le 13ième et le 19ième
siècle, les modes
d'exploitation de la mine n’ont guère évolué: l'équipement du
mineur était
constitué d'une hotte sur le dos, d'une lampe à la bouche, d'une pioche
sur
l'épaule, d'un briquet, d’amadou, de coton, et d’une petite corne
remplie
d'huile d'olive (venue d’Espagne) à la ceinture. Les mineurs étaient
membres
d'une corporation très fermée où l’on entrait par le mariage. Ils
faisaient des
journées de sept heures en hiver et onze heures en été. Les pierriers
ou
piqueurs attaquaient la mine, les gourbatiers
transportaient le
minerai à raison de 90 à 100 Kg par voyage en se hissant sur une rampe
de
quatre cents à six cents mètres de long avec une pente à 80% , la lampe
aux
dents. Tous vivaient dans l'angoisse des éboulements. Il y avait en
moyenne une
soixantaine d’accidents par an avec un ou deux morts et des dizaines
d'handicapés à vie.
Au début
du 19ème siècle l’activité industrielle de la
Haute Ariège
était à son apogée,
et la démographie
à son maximum (on peut presque parler de surpeuplement).
La forêt, qui semblait une
ressource
inépuisable, était utilisée pour des besoins quotidiens des habitants.
La quête
de bois pour faire chauffer la marmite était dévolue aux jeunes filles
et aux
femmes. Après la mise en place du Code Forestier, ce sont elles qui se
sont
trouvées confrontées aux gardes chargés de faire respecter la loi.
Certains
jouaient du prestige de leur uniforme vert pour faire payer aux
contrevenantes
l'amende prévue en nature. Leurs frasques croustillantes ont été
étalées devant
les tribunaux.
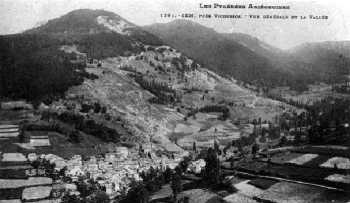 Mais surtout la forêt
était pillée pour
alimenter les forges en charbon de bois (chaque forge engloutissait 100
hectares de forêts par an). Conséquences de cette intense
activité : une
réduction drastique du domaine forestier et une évolution de la
répartition des
espèces. Le pin sylvestre cède la place au hêtre, espèce privilégiée
pour ses
qualités à la fois physique (la droiture des fûts facilite
leur débardement
par les glissières ou par les animaux) et
chimique (c’est un bois de meilleure
qualité pour
le chauffage et le charbon de bois).
Une exception notable : au 17ième
siècle, on a reboisé
en sapins les environs de Lercoul, et on peut encore voir cette vieille
futaie
de sapins
Mais surtout la forêt
était pillée pour
alimenter les forges en charbon de bois (chaque forge engloutissait 100
hectares de forêts par an). Conséquences de cette intense
activité : une
réduction drastique du domaine forestier et une évolution de la
répartition des
espèces. Le pin sylvestre cède la place au hêtre, espèce privilégiée
pour ses
qualités à la fois physique (la droiture des fûts facilite
leur débardement
par les glissières ou par les animaux) et
chimique (c’est un bois de meilleure
qualité pour
le chauffage et le charbon de bois).
Une exception notable : au 17ième
siècle, on a reboisé
en sapins les environs de Lercoul, et on peut encore voir cette vieille
futaie
de sapins
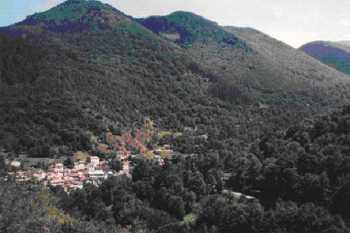 Depuis la
fermeture de la mine en 1931, la forêt a regagné du terrain tandis que
le
village se dépeuplait comme on peut le constater en comparant les deux
clichés
ci-contre, pris à un peu moins d’un siècle d’intervalle
Depuis la
fermeture de la mine en 1931, la forêt a regagné du terrain tandis que
le
village se dépeuplait comme on peut le constater en comparant les deux
clichés
ci-contre, pris à un peu moins d’un siècle d’intervalle