La femme puissance tutélaire
A toutes les époques et dans tous les pays, les montagnes ont été peuplées de Dieux, régnant sur les vies des humains et commandant aux phénomènes météorologiques. Les Pyrénées n’échappent pas à cette règle : les sommets du Canigou, du Puigmal, de l’Aneto, et bien d’autres ont été divinisés. En Béarn, l’accès au pic d’Anie est défendu par le Yauna Gori; j’ai personnellement le souvenir d’une tentative d’ascension du sommet en juillet 2006, interrompue par un orage d’une soudaineté et d’une violence extrême. Même pour un esprit cartésien du 21ième siècle, il était tentant d’imaginer un esprit maléfique repoussant les petits intrus que nous étions à grands coups de grêle et de rafales de vent…
Il n’existe guère que deux figures féminines qui remplissent cette
fonction, à la fois protectrice et menaçante, et on va voir qu’elles le
font de manières radicalement différentes :
Mari
est considérée par les basques comme le chef ou la reine de tous les
esprits qui peuplent le monde, et c’est le personnage clé de
leur
mythologie. Ce point de vue qui émane de José Miguel de Barandiaran,
n’est pas partagé par d’autres auteurs comme Anuntzi ARANA,
pour
qui Mari ne serait qu’une des nombreuses déités du panthéon basque.
Appelée aussi « la dame d’ Anboto »,
Mari est incontestablement une divinité féminine : elle peut
être
représentée sous forme d'une dame vêtue de façon élégante, assise près
du feu et arrangeant sa chevelure ou filant au soleil à l’entrée de sa
caverne ; dans certains récits elle porte dans ses mains un palais en
or. Ailleurs, elle vole en jetant des flammes; elle sillonne les airs
montée sur un chariot tiré par quatre chevaux ou encore en pilotant les
nuages. Elle est parfois représentée sous forme de vautour.
 Il n’est pas étonnant que le personnage de Mari soit si
diversifié : depuis l’apparition de ce mythe, la société
basque a
été confrontée à de nombreuses civilisations (Ibères, Celtes,
Romains,..) et chacune a apporté des éléments de sa propre culture et
de sa mythologie.
Il n’est pas étonnant que le personnage de Mari soit si
diversifié : depuis l’apparition de ce mythe, la société
basque a
été confrontée à de nombreuses civilisations (Ibères, Celtes,
Romains,..) et chacune a apporté des éléments de sa propre culture et
de sa mythologie.
Mari a de nombreux
pouvoirs, dont celui
de déclencher des tempêtes, tout comme son fils Mikelats. Le
seul
fait que Mari se laisse voir est le signe d'une tourmente proche. Dans
beaucoup d'endroits, on pense qu'elle sort les vents et les nuages de
gouffres pour les envoyer sur les villages dont elle veut punir les
habitants. Afin d'éviter les chutes de grêle et autres maux,
on
lui a d’abord fait des sacrifices d’animaux et des offrandes d’argent,
puis après la christianisation des Pyrénées on a eu recours à la
célébration de messes et à des conjurations à l'entrée de certaines
grottes.
Celui qui va consulter Mari ou qui
va lui rendre visite doit se soumettre à certaines
formalités : il
faut la tutoyer, il ne faut pas pénétrer dans sa caverne sans
y
avoir été invité, il faut sortir de la caverne de la même
façon
que l'on y est entré, il ne faut pas s'asseoir alors que l'on est en sa
présence.
Mari est reliée fortement à la terre et
donc au
concept de fécondité. Elle habite le monde souterrain, dans des
demeures richement ornées, où abondent l'or et les pierres précieuses
et dont elle sort par le biais de grottes et gouffres : c'est
pour
cela qu’elle apparaît en de tels lieux plus souvent qu'ailleurs. Mari
possède parfois une jeune captive qu’elle retient dans son antre pour
différents motifs: en accomplissement d’une promesse, ou encore par
suite d’une malédiction prononcée par les parents, ou tout simplement
parce que la jeune fille passait près de l’entrée d’une grotte.
Généralement, Mari la traite correctement, lui donnant une éducation
soignée avant de la libérer avec un cadeau de prix.
Les anciens
disent qu'une jeune fille des environs de Markina s'en alla garder les
brebis à Gabaro et, qu'en s'approchant de la caverne, elle y fut
enfermée par la Dame d'Anboto qui l'éleva comme une très belle
demoiselle : le travail de cette jeune fille consistait à filer sans
cesse, et jamais elle ne sortait dehors. La Dame lui apportait de
l'extérieur tout ce qu'elle désirait. La Dame lui dit un jour :
"Maintenant tu dois sortir."
Mais la jeune fille ne
voulait pas sortir car elle se trouvait bien
dedans. Mais quand elle fut enfin prête à sortir, la Dame lui dit :
"Prends donc une poignée de charbon."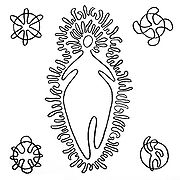
"En quoi ai-je besoin
de charbon ?" répondit la fille.
Quand elle fut dehors,
elle regarda ses mains et vit que tout était de l'or rouge.
L’homonymie du nom Mari avec celui de la mère de Jésus est-elle plus
qu’une coïncidence ? Il est difficile de croire qu'une déité
si
importante, et dont le culte est bien antérieur à la Chrétienté, ait un
nom qui dérive d'une icône chrétienne ; il pourrait dériver du
terme Emari (cadeau) ou Amari (mère) en perdant la première voyelle.
Par contre, il est bien évident que la proximité des noms a favorisé
une tentative de christianisation du mythe et une
« récupération » du culte païen de la déesse Mari
dans une
vénération chrétienne de la Vierge Marie
Dans son livre Femmes pyrénéennes Isaure GRATACOS établit un rapprochement entre le culte d’une déesse aussi puissante et le statut privilégié des femmes dans l’ouest de la chaîne. Du côté du pays basque et du Béarn, on trouve en effet des éléments qui peuvent nous laisser croire à une société relativement égalitaire : en théorie, le droit d’aînesse est absolu et non attaché à la masculinité. La coutume du Lavedan, rédigée en 1704 dit « que les aînés, soit mâles ou femelles indifféremment, sont par un fidéicommis perpétuel, les héritiers de maisons dont ils descendent. » L’épouse peut posséder ses biens propres, dont le mari n’a pas le droit de disposer ; en cas de divorce, la femme récupère son apport. Même sans divorce, la femme peut demander des comptes et récupérer sa dot mise en danger par une mauvaise gestion. Il semblerait que les femmes, ou en tout cas les femmes chef de famille, aient siégé dans les assemblées générales villageoises où elles bénéficiaient du droit de vote. Cette relative égalité existe aussi dans la vie quotidienne : "Chez nous les femmes ne sont jamais restées debout pendant que les hommes mangeaient...." confie un commingeois à Isaure GRATACOS.
D’autres auteurs pensent qu’il convient d’être prudent et de ne pas trop idéaliser le statut des femmes : le droit d’aînesse avait été établi pour des raisons économiques et non pour une quelconque préoccupation égalitaire ; il s’agissait avant tout de ne pas morceler les terres. Les droits accordés aux femmes n’étaient pas toujours appliqués de façon très rigoureuse; et quand une fille héritait c’était souvent par défaut de frères.
Du côté de sa vie privée, Mari
est un personnage
féminin résolument moderne, voire même une « femme
libérée ».
On lui connaît au moins trois compagnons, qui interviennent dans
différentes histoires :
| La
divinité Maju
ou Sugaar : lorsque les deux époux se rencontrent, ils déchaînent une furieuse tempête de pluie et de grêle ! Apparemment les relations à l’intérieur du couple divin sont … orageuses ! |
Diego Lopez : après sa capture par les Maures qui l’emmenèrent en prison à Tolède, Mari aida son fils, Liiko Lopez, en lui donnant un cheval capable de faire l’aller-retour dans la journée. (d’après J. M. de Barandiaran) |
Lopez de Harro : seigneur de Biscaye, fondateur de Bilbao, aurait donné plusieurs enfants à Mari, dont un fils, Inigo Gerra, qui offrait à sa mère les entrailles de toutes les vaches tuées dans sa propriété en les exposant sur une montagne. Cette coutume a duré longtemps chez les seigneurs de Biscaye. Une légende raconte qu’un jour, Lopez de Harro provoqua la disparition de sa femme en faisant le signe de la croix. |
Notons que même mariée, c’est à elle qu’est rendu le culte, et non à son époux. Ses compagnons apparaissent comme des personnages annexes, voire contingents ; Mari n’a pas besoin d’eux pour exister. On est dans le modèle de l’héritière « cap d’oustau » mariée à un cadet : c’est elle le chef de famille, elle qui a le pouvoir et c’est à elle qu’on rend hommage.
Le mariage était arrangé par les familles, mais relativement dissocié de la vie sexuelle, et il semble que les femmes jouissaient dans ce domaine d’une certaine liberté, du moins avant le mariage. Au XVIIIe siècle, les évêques de Bayonne fulminaient contre les « mariages à l'essai », apparemment courants au Pays Basque. Mais il s’agissait moins dans ce cas de véritable liberté (n’oublions pas que le mariage est décidé par les familles) que de s’assurer de la fertilité du couple avant de conclure le contrat, la naissance d’un héritier étant nécessaire pour la pérennité de la lignée.
Quant au concubinage, il paraît avoir été reconnu officiellement par contrats en Béarn. Ainsi Guilhem deu Cog, charpentier, et Gailhardine de Pardies, mariés chacun de leur côté, se promettent mutuellement de s'épouser quand ils seront veufs. En attendant, Guilhem s'engage à entretenir Gailhardine "comme concubine".
 L’autre déité féminine du panthéon pyrénéen est bien différente de
Mari. Basa
Andere
est toujours présentée comme la compagne de Basa Jaun, Seigneur des
montagnes de la Soule. L'existence d’un tel couple de génies est
fréquent dans la mythologie celte et pourrait symboliser l'union d'une
communauté primitive avec son territoire.
L’autre déité féminine du panthéon pyrénéen est bien différente de
Mari. Basa
Andere
est toujours présentée comme la compagne de Basa Jaun, Seigneur des
montagnes de la Soule. L'existence d’un tel couple de génies est
fréquent dans la mythologie celte et pourrait symboliser l'union d'une
communauté primitive avec son territoire.
Certaines légendes concernant Basa Jaun le présentent comme un être cruel capable de terribles actions. Mais il semble plutôt être le véritable Seigneur de la forêt d'Iraty punissant les hommes qui le méritent et récompensant ceux qui lui montrent du respect et font preuve de générosité. Basa Andere, quant à elle, passe de longs moments à peigner sa chevelure, à l'aide d'un peigne d'or et ses richesses provoquent la convoitise des bergers.
Un grand chandelier en cuivre qui se trouve dans la chapelle de Saint-Sauveur d’Iraty proviendrait du trésor de Basa Andere : un jour alors qu’elle était en train de le frotter pour le faire briller, un berger s'empara de l'objet rutilant et s'enfuit à toutes jambes. Basa Jaun, alerté par les cris de sa compagne, prit l'homme en chasse à travers les hauteurs d'Iraty. Près d'être atteint, le berger se réfugia dans la chapelle dont il se mit à sonner la cloche, faisant fuir le Seigneur Sauvage.
Ce récit est intéressant à deux égards : d’abord parce que l’on retrouve deux des thèmes qui sont très souvent associés à la femme dans la mythologie pyrénéenne : le fait de se peigner les cheveux, et les objets en or. Ensuite, parce qu’il permet de voir la différence entre Mari et Basa Andere : cette dernière ne règle pas ses problèmes elle-même mais délègue à son compagnon le soin de le faire. On est ici en plein dans la distribution classique des rôles sociaux : à la femme appartient le caractère sensuel (symbolisé par les cheveux) et à l’homme la force physique pouvant aller jusqu’à la brutalité.
Les deux divinités féminines pyrénéennes nous offrent donc deux visions de la femme radicalement opposées: l’une est une puissance tutélaire souveraine, l’autre reste dans l’ombre de son compagnon qui détient le pouvoir. La mythologie permet à chacun de trouver des arguments pour alimenter ses propres convictions… même s’il est vrai que « nulle part n’a été prouvé qu’une religion avec des divinités féminines produise un matriarcat dans le domaine socio-politique » (Anuntzi ARANA).
Personnellement, je trouve assez séduisante la cohabitation des deux modèles qui correspondent aux deux statuts possibles pour les femmes pyrénéennes : souveraines lorsqu’elles étaient « airetera » (héritières) mais taillables et corvéables à merci lorsqu’elles avaient la malchance de naître cadettes et d’être destinées à « aller belles filles ».